L'atelier BOOST-IN, organisé par Ecofilae le 3 avril 2025 à Montpellier, a réuni des experts et des collectivités pour aborder le sujet de la réutilisation des eaux usées traitées (REUT) pour la production d'eau potable. Cet événement s'inscrit dans le cadre du projet européen éponyme, dont l'ambition est d'accélérer l'adoption de solutions innovantes et de lever les freins sociétaux, réglementaires et techniques de cette pratique.
Expert sur les questions de sobriété hydrique et spécifiquement sur la production d'eau potable à partir d'eaux usées traitées, Rémi Declercq, Directeur de projets R&D Ecofilae, a animé l'atelier, aux côtés de Cameron Mc Lennan, Ophélie Pratx, chefs de projets, et Nicolas Condom, président Ecofilae, en conviant les participants à la réflexion sur les grandes questions de l'IPR (Indirect Potable Reuse) :
- Quels sont les enjeux de cette pratique ?
- Quels sont les projets inspirants ?
- En quoi consiste-t-elle ?
Ecofilae vous livre ci-dessous son analyse tout en s’appuyant sur l’atelier développé pour le projet BOOST-IN.

Les enjeux de la réutilisation des eaux usées traitées (REUT) pour la production d'eau potable
Levier stratégique pour l'approvisionnement en eau potable, motivé par des enjeux environnementaux et socio-économiques, la réutilisation des eaux usées traitées pour la production d'eau potable vise à réduire la pression sur les ressources naturelles et de faire face aux risques de pénurie.
La principale préoccupation technique réside dans la maîtrise des risques sanitaires liés à la présence de contaminants dans les eaux usées traitées (EUT). La présentation de Julie Mendret (Université de Montpellier) a souligné lors de cet atelier les deux types de risques majeurs :
- Contamination microbiologique : due aux micro-organismes pathogènes (bactéries comme Escherichia Coli, virus gastro-entérite, parasites comme Giardia).
- Contamination physico-chimique : due aux micropolluants (résidus de médicaments, pesticides, produits cosmétiques, hormones, solvants).
L'objectif est d'appliquer des procédés d'affinage robustes pour garantir la qualité de l'eau. Ces procédés incluent l'osmose inverse, la nanofiltration, le charbon actif (granulaire ou biologique), l'ozonation et la désinfection UV...
Les enjeux d'acceptabilité sociale de la réutilisation des eaux usées traitées
La planification de la REUT, qu'elle soit Indirecte (IPR - via un tampon environnemental) ou Directe (DPR), nécessite une forte appropriation sociale. L’adhésion du grand public et le travail de sensibilisation des populations par les collectivités et parties prenantes des projets est la clé de la réussite des projets, à travers des actions de formations par exemple.
À titre d’exemple, le Programme JOURDAIN utilise son démonstrateur, sur lequel Ecofilae a été mobilisé lors de la première phase du projet, comme un outil de concertation auprès du public, notamment via des visites et des « laboratoires du goût de l'eau », afin de lever les freins psychologiques et de soutenir l'évolution réglementaire nécessaire.
BOOST-IN : des ateliers pour comprendre la démarche et favoriser l’accélération
L'atelier s'est concentré sur l'accompagnement des acteurs du secteur pour sécuriser leurs projets, réduire leur empreinte eau et passer de l'idée au projet opérationnel.
Deux types de réutilisation ont été abordés :
- Réutilisation indirecte pour production d’eau potable (IPR) : Réintroduction des EUT dans une masse d'eau (rivière, nappe), servant de « tampon environnemental », avant un nouveau traitement en usine de potabilisation.
- Réutilisation directe pour la production d’eau potable (DPR) : Injection de l'EUT directement dans le réseau d'eau potable ou immédiatement en amont du traitement final.
Les participants ont pris part à deux ateliers thématiques pour la maturation des projets :
- Atelier 1 : Perceptions sociales et enjeux territoriaux (en commun).
- Atelier 2 : Freins et solutions (en sous-groupes IPR et DPR) : Démarche projet, mobilisation des parties prenantes, identification des risques et élaboration de solutions concrètes.
Des retours d'expériences pour inspirer et améliorer les futurs projets de production d'eau potable à partir d'eaux usées
L'atelier a présenté trois cas d'études emblématiques de la réutilisation indirecte, offrant des perspectives techniques et contextuelles variées.
Le Programme JOURDAIN (Vendée Eau, France) par Elisabeth Macé et Alexandre Baudouin
Le programme JOURDAIN est un projet pionnier en France, visant à sécuriser la ressource grâce à la REUT IPR. Le système intègre :
- Une unité d'affinage dotée d'un traitement avancé par ultrafiltration, osmose inverse basse pression, UV et chloration ;
- Une canalisation de 27km ;
- Une Zone de Transition Végétalisée (ZTV) pour la réoxygénation et la renaturation, avant le transfert de l'eau dans la retenue du Jaunay.
Ce projet est conçu comme une expérimentation grandeur nature (jusqu'en 2027) visant à démontrer la faisabilité technique et l'innocuité du procédé, tout en cherchant à mobiliser le financement nécessaire et à faire évoluer la réglementation française.

Le projet AquaDuin (Coxyde, Belgique) par Emmanuel Van Houtte
Ce retour d'expérience a présenté la mise en œuvre de la ré-infiltration de la nappe pour un usage potable depuis 23 ans. Ce système de Recharge Artificielle des Nappes (MAR) a été instauré en 2002 pour répondre à la double problématique de l'augmentation de la demande et de l'intrusion d'eau salée dans les aquifères côtiers. L'exploitation des eaux souterraines, régénérées via cette méthode, est considérée comme un moyen de production plus sécurisé et plus durable pour l'avenir de la région de Coxyde.
Le projet de Llobregat (Barcelone, Espagne) par Jordi Molist (GenCat)
Le projet Llobregat est l'illustration d'une REUT indirecte déjà opérationnelle, essentielle pour la résilience hydrique. Le dispositif consiste à injecter l'eau récupérée et traitée dans le fleuve Llobregat à 8 km en amont de l'usine de potabilisation de Barcelone. Cette solution, activée en période de crise et prévue par le Plan Sécheresse, a permis d'économiser plus de 60 millions de m³ d'eau stockée en réservoirs au cours des deux dernières années, évitant ainsi des pénuries.
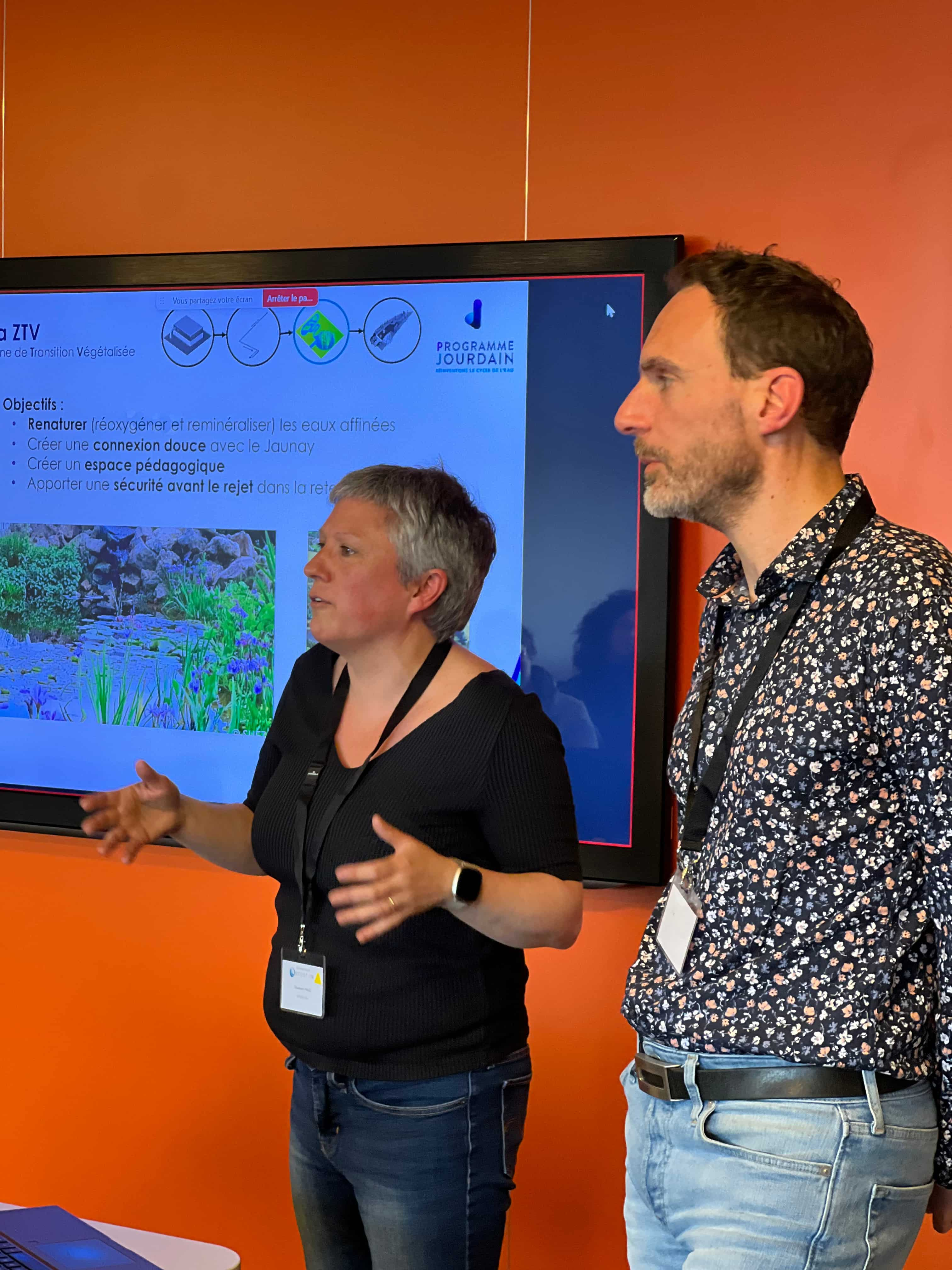
En quoi consiste la production d’eau potable à partir des eaux usées traitées ?
La production d'eau potable à partir d'eaux usées traitées (ou potabilisation directe/indirecte) nécessite un traitement d'affinage rigoureux et performant, allant évidemment bien au-delà de l'épuration classique. A titre d’illustration des procédés de traitement généralement mobilisés pour cette pratique :
- Filtration membranaire : Des membranes de plus en plus fines sont utilisées, notamment l'ultrafiltration et la nanofiltration, pour éliminer les particules, les bactéries, les virus et une grande partie des micropolluants. L'osmose inverse est l'étape la plus poussée, permettant de filtrer les sels dissous et les molécules les plus petites, garantissant une eau d'une pureté exceptionnelle, souvent supérieure à certaines ressources naturelles.
- Adsorption sur charbon actif : Le charbon actif en grain (CAG) ou en poudre (CAP) est utilisé pour adsorber les micropolluants (résidus de médicaments, pesticides, produits cosmétiques, etc.) qui n'auraient pas été totalement éliminés lors des étapes précédentes.
- Procédés d'oxydation avancée (POA) : L'utilisation de l'ozonation ou des UV permet de décomposer les micropolluants restants et d'assurer une désinfection complète des virus et bactéries pathogènes.
Le contrôle qualité et la reminéralisation
Une fois l'eau purifiée, des systèmes de surveillance en temps réel (suivi rigoureux des virus, œstrogènes, etc.) assurent le respect des normes de qualité de potabilité les plus strictes. L'eau est ensuite souvent reminéralisée (avec ajout de CO2 par exemple) pour équilibrer son pH et améliorer ses qualités organoleptiques (goût) avant d'être distribuée ou de réalimenter une nappe (potabilisation indirecte).
Les pionniers de la potabilisation (milieu du XXe Siècle)
La potabilisation directe à partir d’eaux usées traitées s’est développée dans des régions confrontées à une pénurie d'eau chronique :
- Windhoek, Namibie (1968) : La capitale namibienne est souvent citée comme la pionnière mondiale de la potabilisation directe à grande échelle. L'usine de Goreangab recycle les eaux usées traitées pour fournir une partie significative de l'eau potable de la ville, une nécessité dans ce climat désertique. Aujourd'hui, 30 % des eaux usées de la capitale sont recyclées en moins de dix heures.
- États-Unis : De grands projets ont vu le jour, notamment en Californie (Orange County Water District) et au Texas, misant initialement sur la potabilisation indirecte (réinjection dans les nappes phréatiques pour filtration naturelle supplémentaire) avant d'évoluer vers des projets de potabilisation directe.
- Singapour : L'État a fait de l'autosuffisance en eau une priorité. Le succès de son programme, baptisé NEWater, a permis de transformer un "effet beurk" initial en une fierté nationale, donnant au pays plus d'indépendance vis-à-vis de son principal fournisseur historique, la Malaisie.





